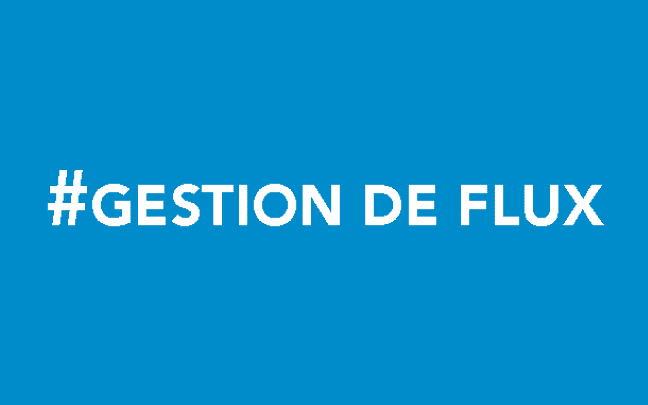Interview de Jean-Marie Duthilleul, Architecte

Les grands événements : tout commence dès la conception de la gare
Comment construire une gare qui doit accueillir et ramener chez elles 40 000 personnes en une heure ? Comment anticiper les comportements des voyageurs ? Jean-Marie Duthilleul, ingénieur et architecte de la gare de la Plaine Saint-Denis, raconte comment concevoir une gare d'une telle ampleur et l'évolution de la construction des gares au fil des années.
Quelles précautions avez-vous prises lors de la construction de la gare de la Plaine ?
Pour une telle gare, il faut d’emblée réfléchir sur deux plans.
D’abord sur le plan psychologique : à l’aller, le supporter doit voir le stade dès l’arrivée en gare, d’où le fait que la vue d’en haut soit dégagée : ça rassure. Au retour, chacun doit pouvoir anticiper son chemin, c’est-à-dire voir la gare de loin. Celle-ci doit par ailleurs avoir une image suffisamment mémorisable pour qu’on la reconnaisse. Et une gare aérienne telle que celle de la Plaine permet de voir les RER circuler : ainsi, même au centre de la foule, je vois les trains donc je ne m’inquiète pas. A l’aller comme au retour, il y a un effet d’anticipation : soit sur le stade, soit sur le train qui va m’emmener.
Ensuite sur le plan fonctionnel : il faut faire monter ou descendre à pied les gens sur des installations fixes pour n’être jamais soumis à une panne. On introduit donc un cheminement continu via ces rampes où les flux s’écoulent très bien.
Il y a ensuite un sujet de géométrie pour que ces rampes, à l’arrivée au stade, prennent les gens au plus près des trains. Quatre rampes les regroupent progressivement sur deux autres qui les dirigent vers la voie menant au stade, Au retour, l’objectif est au contraire qu’elles servent à éparpiller les gens sur l’ensemble du quai puisque ce sont des rames qui arrivent toutes les 3 minutes pour prendre 1500 personnes. Il faut donc que les 1500 personnes soient bien positionnées sur le quai. Les voyageurs passent donc de deux à quatre rampes, pour être mieux positionnés sur les quais.
Le choix des matériaux est également très important pour créer un environnement doux et non agressif pour les gens. C’est la raison pour laquelle on a choisi le bois du début à la fin, car dans la perception des gens et dans l’univers technique ferroviaire, le béton et l’acier sont considérés comme des matériaux brutaux et lourds alors que le bois est beaucoup plus domestique et appréhendable. Donc faire cheminer des gens sur du parquet et leur mettre en plafond un plancher de bois, c’est les amener dans une atmosphère domestique moins génératrice de violence. Par ailleurs, ces matériaux nous ont permis d’atténuer le son. Sur les quais, les foules font beaucoup de bruit et on doit pouvoir s’entendre. Cela fait partie de l’ambiance finale, les gens doivent pouvoir se parler même s’ils sont dans une atmosphère confinée.
Enfin, une foule, c’est haut. Vous pouvez faire habiter cinq personnes sous 2,50m de plafond mais vous ne faites pas habiter 1000 personnes sous 2,50m de plafond. On a donc voulu que les gens aient toujours une grande hauteur de plafond pour qu’ils ne se sentent jamais enfermés.
Est-ce qu’on conçoit les autres gares de la même manière ?
Il y a un point commun : l’anticipation du cheminement est une règle indispensable lorsqu’il s’agit de traverser un espace. Dans le cas d’une gare de stade, je vais du stade à la gare, mais dans les autres gares, je vais du bus, d'une station vélo, du parking etc. au train. Il y a donc une multiplicité de chemins à prendre en compte. Plusieurs scénographies doivent se conjuguer pour anticiper sur chacun de ces cheminements.
De même, en termes de visibilité, quand on dessine une gare avec des changements de niveaux, il faut s’attacher à ce que le voyageur ait au-dessus de la tête non pas l’endroit où il se trouve mais bien l’endroit où il se rend. L’idée est que je dois voir l’espace où je vais. Du haut d’un escalier mécanique, je dois avoir des cadrages : des cadrages sur les trains, les restaurants, bref, ce dont j’ai besoin selon mon cheminement. Pour une gare de stade, c’est cadré sur le stade ou le train. Une gare de stade ou une gare ordinaire doivent toutes deux comporter plusieurs modes d’accès et plusieurs cadrages.
Finalement, en termes de flux de personnes, une gare se conçoit un peu comme un cinéma.
Vous travaillez avec des psychologues, des sociologues ?
Oui. Quand on a rénové la Gare du Nord, on a travaillé avec les psychiatres de l’hôpital Fernand Widal qui recueille tous les gens qui « pètent les plombs » dans une gare. Ces psychiatres avaient une connaissance très fine de ce qui peut être ressenti comme une agression de défense : par exemple, pour certains voyageurs, il n’y a rien de plus agressif que les tourniquets de contrôle des tickets. J’en ai vu certains s’énerver contre les machines en tapant dessus et en les traitant de tous les noms ! C’est un mécanisme de défense.
Par ailleurs, en anticipation de crise, il faut voir des médecins, des psychologues, des chefs de gare, bref, des personnes adaptées pour analyser les comportements des gens. Un chef de gare de SNCF a une connaissance très fine des comportements des gens !
Un point intéressant à noter sur le plan psychologique : les comportements erratiques sont beaucoup plus craints dans les petites gares, alors que dans une gare de stade, la foule a un côté dissuasif.
Et avec les changements de comportements et leur évolution, est-ce que l’on construit différemment les gares ?
Un vrai sujet depuis 30 ans est l’évolution du regard des gens : aujourd’hui, ils ne voient plus du tout les mêmes choses. Par exemple, la profondeur de champ est limitée à 2,50m – 3m, au-delà, ils ne voient pas bien. De même, la largeur de champ diminue énormément. Je pense que c’est lié aux écrans – téléphones et tablettes notamment – et au fait qu’on a le regard très fixé dessus. Aujourd’hui, pour aider les gens à se repérer lorsqu’ils sont démunis d’écran, il faut être beaucoup plus insistant !
Deux solutions :
Les individus voient toujours bien ce qui bouge, alors on profite des moments où eux-mêmes bougent (sur un escalier mécanique par exemple) pour faire glisser des plans les uns par rapport aux autres. Ce phénomène d’apparition/disparition est un phénomène auquel on est beaucoup plus attentif qu’auparavant pour attirer l’attention.
Par ailleurs, les effets de contraste avec l’ombre, la lumière comptent beaucoup aussi : ces éléments « doux » ne sont plus efficaces pour guider les voyageurs. Par exemple, ils ne perçoivent plus une transition de lumière douce du sombre au clair. Il faut des « accidents », des accrocheurs de regard.
Aujourd’hui, lors de la construction d’une gare, vous la construisez en fonction de ces écrans ?
Dans les gares du Grand Paris ou d’Eole, on fait des effets vertigineux. Il faut qu’il y ait une expérience physique beaucoup plus forte, plus ressentie du fait de l’écran de téléphone devenu très concurrent de l’espace réel. Car l’écran déconnecte et met les gens dans une bulle. Ce qui d’ailleurs crée un problème sociologique plus grave : le temps du trajet n’est plus un temps de rencontre et de création de lien social. Or, un des principaux objectifs d’une gare est de mettre les gens en relation. Aujourd’hui, c’est plus compliqué.
La foule commence à combien de personnes ?
Toute foule est relative à l’espace dans lequel elle est inscrite. Ainsi, 50 personnes dans un appartement de 50m2 constituent une foule, mais non dans une gare ou sur un quai !
Photo : Christophe Cagnard